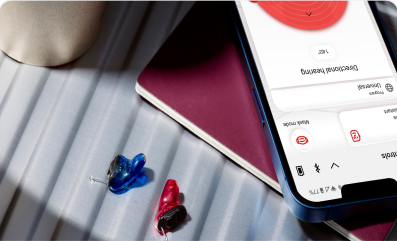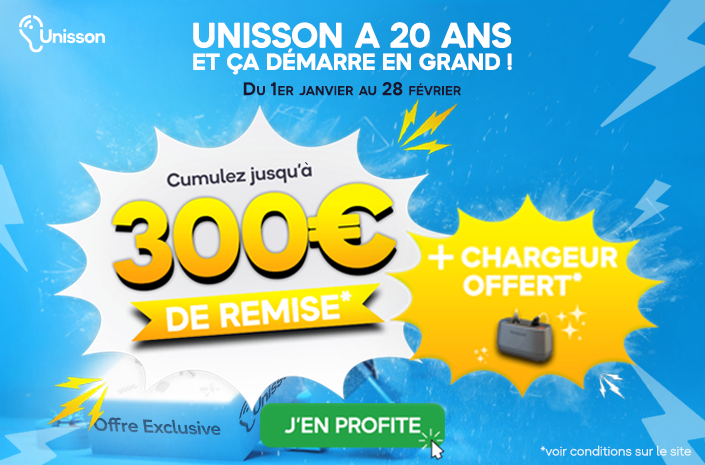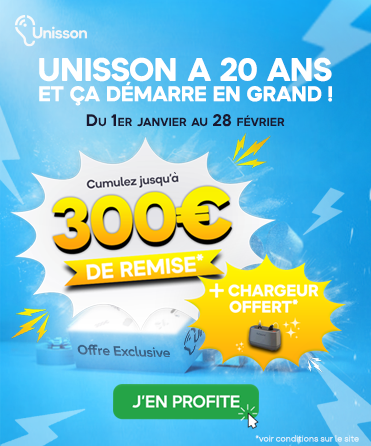Sommaire
De 9h à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 12h le samedi
Effectuez un bilan auditif complet et gratuit avec un audioprothésiste au sein de nos laboratoires.
Génétique, héréditaire, congénital: quelles différences ?
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de clarifier certains termes souvent confondus.
Lorsqu’on parle de surdité héréditaire, cela signifie qu’elle a été transmise par les parents à l’enfant, à travers l’ADN. Elle peut ne pas apparaître à chaque génération, mais une récurrence familiale est généralement observée.
Une maladie génétique, quant à elle, est liée à une altération des gènes. Cela peut être héréditaire… ou non. La trisomie 21, par exemple, est une anomalie génétique, sans forcément être transmise par les parents.
Enfin, une surdité congénitale est présente dès la naissance. Elle peut être d’origine héréditaire ou résulter d’un événement survenu pendant la grossesse (infection, prématurité, complication lors de l’accouchement…).
Chez les jeunes enfants, une perte auditive peut aussi être acquise à cause d’une maladie (méningite, otites fréquentes, etc.) ou de facteurs environnementaux.
Il est donc possible de voir naître un enfant sourd dans une famille entendante, ou inversement, des parents sourds donner naissance à un enfant entendant. La transmission de la surdité ne suit pas toujours un schéma simple et prévisible.
Est-ce que la surdité est génétique ?
La surdité infantile représente une anomalie relativement fréquente, touchant environ une naissance sur mille dans les familles sans antécédents. Cette déficience auditive, lorsqu’elle n’est pas diagnostiquée et prise en charge rapidement, peut entraîner des difficultés considérables dans l’apprentissage du langage et conduire à des échecs scolaires. D’où l’importance d’un dépistage précoce et d’une identification précise des causes.
Quel pourcentage de surdité est héréditaire ?
Contrairement à certaines idées reçues, parmi les enfants nés avec une surdité, seulement 5% ont un ou deux parents sourds. Notez que les troubles d’origine génétique peuvent se manifester à différents moments de la vie – parfois très tôt, parfois beaucoup plus tardivement. Ainsi, de nombreux cas de surdité sans cause apparente sont en réalité des surdités génétiques qui se manifestent plus tard dans la vie.
Quelles sont les causes de la surdité à la naissance ?
Chez le nourrisson ou l’enfant, la surdité peut être causée par diverses maladies infectieuses contractées par la mère pendant la grossesse, notamment la rubéole, la toxoplasmose ou le cytomégalovirus.
Le développement des organes durant la vie intra-utérine comporte des périodes critiques. Pour l’audition, cette période se situe aux alentours de la cinquième semaine de grossesse. Si la mère contracte la rubéole à ce moment précis, le risque de surdité congénitale devient particulièrement élevé.
La toxoplasmose ou le cytomégalovirus sont également deux infections pouvant également affecter le fœtus. Ces infections peuvent causer non seulement une surdité, mais parfois aussi une surdicécité (atteinte auditive et visuelle), comme dans le cas du syndrome de Usher. Cette maladie génétique rare associe des troubles auditifs, visuels et parfois de l’équilibre.
D’autres facteurs peuvent intervenir à la naissance ou juste après :
- Une privation d’oxygène pendant l’accouchement (souffrance fœtale)
- Une jaunisse sévère (ictère)
- Une naissance prématurée
- Certaines maladies comme la méningite, l’encéphalite ou les oreillons
Toutes ces situations peuvent entraîner une perte auditive, temporaire ou définitive, plus ou moins sévère selon les cas.
Surdité génétique : quel est le gène impliqué ?
Il existe plus d’une centaine de gènes impliqués dans les cas de surdité associée à un syndrome ou à une malformation. Ces gènes sont transmis au moment de la conception, et leur mode de transmission peut être dominant ou récessif.
Lorsqu’un gène dominant est en cause, une seule copie du gène muté suffit pour que la surdité se manifeste. Cela signifie qu’un parent atteint a une forte probabilité de transmettre la surdité à son enfant.
Parmi les syndromes à transmission dominante, on retrouve :
- Le syndrome de Treacher Collins, caractérisé par une surdité et des malformations faciales.
- Le syndrome branchio-oto-rénal, qui touche à la fois l’oreille (interne, moyenne ou externe) et les reins.
- Le syndrome de Waardenburg, associant perte auditive et anomalies de pigmentation des yeux, cheveux ou peau.
Lorsqu’un gène récessif est en cause, il doit être hérité des deux parents pour que la maladie se déclare. Ainsi, des parents entendants peuvent avoir un enfant sourd s’ils sont tous les deux porteurs du gène en question.
Les syndromes associés à une transmission récessive comprennent notamment le syndrome de Usher le syndrome de Jervell et Lange-Nielsen, le syndrome de Pendred ou encore le syndrome de Cockayne.
Comment dépister une surdité héréditaire chez le nouveau-né ?
Un enfant dont la surdité n’est pas dépistée ou prise en charge très tôt risque, au minimum, de souffrir d’un retard dans l’acquisition du langage. C’est pourquoi il est essentiel de procéder à un diagnostic précoce pour tous les enfants.
Les signes qui doivent alerter les parents et les professionnels de santé incluent :
- L’absence de réaction du nourrisson aux stimuli sonores
- La perte progressive du babil après six mois
- Un retard dans l’apprentissage du langage
- Des émissions vocales incontrôlées
- Des troubles du comportement
- Des difficultés scolaires
Le dépistage néonatal a été généralisé dans les maternités françaises depuis 2014, conformément aux arrêtés du 23 avril 2012 et du 3 novembre 2014 relatifs à l’organisation du dépistage de la surdité permanente néonatale. Ce dépistage systématique permet d’identifier très tôt les enfants à risque et de mettre en place rapidement les interventions nécessaires.
Le dépistage à l’école constitue une seconde opportunité de détection. Au cours de la quatrième et de la sixième année, les enfants bénéficient d’un examen de santé effectué par la PMI (Protection Maternelle et Infantile) ou le médecin scolaire. Cet examen comprend un repérage des troubles sensoriels auditifs, permettant de détecter d’éventuelles surdités qui n’auraient pas été identifiées plus tôt.
Surdité héréditaire : quelles solutions ?
Face à la surdité héréditaire, plusieurs options thérapeutiques et d’accompagnement existent pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées.
Appareils auditifs
Les appareils auditifs sont conçus pour amplifier les sons qui passent par le conduit auditif, les rendant plus perceptibles. Selon le type et le degré de surdité, différents modèles d’appareils auditifs peuvent être proposés, certains étant particulièrement adaptés aux cas de surdité de perception, où le problème se situe au niveau du traitement du signal sonore.
Les appareils auditifs sont de plus en plus sophistiqués, discrets et performants, adaptés aux besoins spécifiques de chaque patient. Certains modèles récents peuvent même se connecter à des smartphones ou d’autres appareils électroniques, offrant ainsi des fonctionnalités supplémentaires.
Implants cochléaires
Pour les personnes souffrant de surdité sévère à profonde, les implants cochléaires représentent souvent une solution efficace. Contrairement aux appareils conventionnels qui amplifient simplement le son, ces dispositifs contournent les parties endommagées de l’oreille pour transmettre directement les signaux sonores au nerf auditif. L’implant se compose d’une partie externe (microphone, processeur vocal et transmetteur) et d’une partie interne implantée chirurgicalement (récepteur-stimulateur et électrodes).
L’implantation cochléaire nécessite une intervention chirurgicale et un suivi régulier, mais elle peut permettre de percevoir les sons environnants et même de comprendre la parole. Les résultats varient considérablement d’une personne à l’autre, et dépendent de nombreux facteurs comme l’âge d’implantation, la durée de la surdité avant l’implantation, et la présence d’autres troubles associés.
Quel que soit le type d’appareillage choisi, une prise en charge précoce et un accompagnement personnalisé restent essentiels pour maximiser les bénéfices de ces solutions technologiques.
Votre trouble auditif nécessite un appareillage ? Les audioprothésistes diplômés d’État d’Unisson sont à votre disposition pour vous recevoir et déterminer la solution la plus adaptée à votre situation. Munis de votre prescription médicale, vous pouvez prendre rendez-vous dans un centre Unisson pour découvrir l’appareil auditif qui répondra le mieux à vos besoins spécifiques.
Télécharger notre guide de l'appareillage auditif
Trouver un centre Unisson